
Six jours après les dix ans de la révolution, la fièvre des émeutes nocturnes gagne les villes tunisiennes, de Bizerte à Kebili, malgré le présumé couvre-feu sanitaire en vigueur. Délinquance organisée ou révolte des affamés ? Retour sur ces nuits très mouvementées.
Troubles sociaux – mode opératoire
Les affrontements se déclenchent en début de soirée et s’intensifient progressivement. Le mode opératoire est simple : brûler des pneus, scander des slogans hostiles au pouvoir en place, défier les forces de l’ordre et finir, parfois, par piller les voitures, les commerces, les établissements financiers et les institutions étatiques et privées aussi.
Selon les autorités sécuritaires, ces actes, menés par des petits groupes d’adolescents souvent mineurs et déscolarisés, sont une atteinte illégitime aux biens d’autrui. Alimentés par des jets de pierre, des cocktails molotovs et des bombes lacrymogènes, les mouvements sont en train de se généraliser et touchent plusieurs quartiers populaires.
Si la version du ministère de l’Intérieur met l’accent sur les violences, le vandalisme et le pillage, le point de vue sociologique révèle une anxiété collective et un désespoir social. Malgré la chute du régime de Ben Ali et le clan Trabelsi, “le système” demeure le même. La pauvreté et les inégalités régionales persistent et les grèves et heurts se multiplient.
Pour le sociologue Mohamed Jouili, la contestation sociale ne se limite plus à un créneau horaire comme ce fut le cas avec les protestations nocturnes ayant marqué la révolution. Ces manifestations sont souvent accompagnées par des pillages et ce phénomène n’est pas étranger à la Tunisie, en raison de la désillusion socio-économique, analyse-t-il.
Répression policière
En face, les autorités préfèrent le traitement policier répressif au dialogue constructif. Plusieurs personnes ont été violemment interpellées à Tunis et dans les quatre coins du pays pour avoir participé à des manifestations pacifiques, loin de tout acte de pillage. Des centaines de personnes ont été arrêtées depuis le début de la vague des émeutes, condamnés par de nombreux politiciens ayant encensé les actes de pillage en 2011.
Des organisations de la société civile sont, récemment, montées au créneau pour contester la riposte policière, le mutisme des autorités et tous les actes de vandalisme. Ces ONG expriment leur soutien aux manifestations pacifiques contre “les politiques de marginaliser et d’affamer le peuple et la mise en échec des objectifs de la Révolution”.
Une position partagée par l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), principal syndicat ouvrier, qui rappelle avoir mis en garde contre une éventuelle explosion sociale.
“La colère qui anime la jeunesse tunisienne, épuisée par le chômage, la marginalisation, la pauvreté, la discrimination, les inégalités sociales et le désespoir, est légitime après tant d’années d’échec et de confusion politique. Nous avons tiré la sonnette d’alarme et mis en garde contre une explosion sociale résultant de l’incapacité des gouvernants à trouver des solutions efficaces et de leur attention uniquement portée et depuis 2011, sur le positionnement et le partage des butins”, rapporte le communiqué de l’UGTT.
L’origine du mal
À l’origine de ce chaos socio-économique, le régime parlementaire mixte avec un exécutif bicéphale, démocratique et multipartite, qui bloque l’application des réformes nécessaires, et la politique des compromis mercantiles menée par Ennahdha, le parti au pouvoir depuis la révolution, incapable de constituer une majorité parlementaire stable.
En effet, les chefs de gouvernement se succèdent et demeurent dépendants de la stratégie du mouvement islamiste, caractérisée par l’absence de vision et de projet… Et Hichem Mechichi, actuel pensionnaire de la Kasbah, inapte à proposer une solution concrète pour freiner la crise multidimensionnelle, illustre au mieux cet échec. D’ailleurs, sa dernière sortie médiatique à ce sujet, sévèrement critiquée sur la toile, réaffirme la rupture totale entre le discours des politiques et la jeunesse désabusée.
Pendant ce temps, des voix s’élèvent pour ne pas sous-estimer la révolution des affamés. Le responsable nahdhaoui, Samir Dilou rejette le déni politique, les affirmations selon lesquelles les jeunes en colère dans les rues ont été payés pour passer à l’action et crier à la révolte et la qualification de ces troubles comme des actes de pure délinquance.
“Il y a un problème réel et il ne faut pas non plus blâmer ceux qui veulent en tirer profit. Il faut pointer du doigt ceux qui étaient au cœur du problème et oser déceler les difficultés socio-économiques qui sont derrière ces mouvements”, explique-t il à la radio.
Le leader au sein d’Ennahdha, au pouvoir depuis 2011, n’est pas allé par quatre chemins pour appeler “un grand nombre d’élites politiques à céder leurs places, notamment ceux qui n’ont pas pu assumer leur responsabilité et changer les choses par des réformes à long terme, outre les mesures à court terme pour améliorer la vie des citoyens”.
Dix ans après la chute de la dictature, l’allégresse générale a cédé la place à une instabilité politique chronique, une dégringolade économique continue, un péril social sans précédent et une dépression collective très sévère après des années de désillusion. La colère, même réprimée, se transmet l’air de rien, mais Ennahdha et cie préfèrent opter pour le déni, alors que l’État est aux portes de l’effondrement.
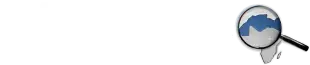






Ce n’est ni une révolte, ni une révolution, ni un ras-le-bol. C’est une image à grande échelle des bagarres et de l’anarchie qui règnent à l’intérieur du parlement à chacune de ses séances. Quand le sang coule au sein de l’ARP, il faut s’attendre au pire dans la rue. Autrement dit : Tel parlement tel peuple.